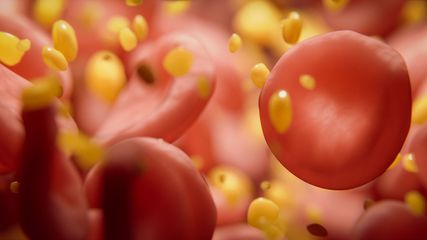«Planetary Health»: l’interaction entre la santé et le changement climatique
Compte-rendu:
Dr méd. Sabina Ludin
Rédactrice en chef
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Le changement climatique est une réalité depuis longtemps. En Suisse, les dix dernières années ont été 2,5°C plus chaudes que la moyenne pendant la période préindustrielle et les températures continuent d’augmenter. Cela a de multiples conséquences sur la santé, comme l’a clairement démontré la Dre méd. Emily West, médecin-chef de clinique, Clinique des maladies infectieuses et d’hygiène hospitalière, Hôpital universitaire de Zurich, lors du congrès de printemps de la SSMIG.
La dernière étude Global Burden of Disease Study révèle que l’exposition aux particules fines figure en tête de la liste des facteurs de risque spécifiques pour les années de vie corrigées de l’invalidité (DALYs) perdues dans le monde, comme c’était déjà le cas en 2000.1 «8% de tous les dommages sont causés par l’exposition aux particules fines. Cela dépasse les effets de l’hypertension, du tabagisme ou du diabète. Nous, les clinicien·nes, ne semblons toutefois pas avoir de visibilité sur cette question», a déclaré E. West en guise d’introduction.
Le problème est double. D’une part, le changement climatique a un impact important sur la santé. D’autre part, le secteur de la santé influence lui-même le climat en raison de la consommation accrue de ressources et des émissions qui en découlent.
Impact du changement climatique sur la santé
«Vous avez certainement remarqué l’augmentation des maladies allergiques dans votre cabinet au cours des dernières années», a déclaré E. West. En raison du réchauffement climatique ainsi que de l’arrivée précoce du printemps et celle tardive de l’automne, nous sommes également exposées à une charge pollinique nettement plus élevée en Suisse. À Genève, elle a par exemple augmenté de 2,3% chaque année au cours des 26 dernières années.2 Cependant, le pollen peut non seulement provoquer des réactions allergiques, mais aussi rendre plus vulnérable aux infections des voies respiratoires virales en réduisant la réponse antivirale interféron. Cet effet se produit aussi bien chez les personnes allergiques au pollen que chez celles qui ne le sont pas. Une grande étude a analysé les données de 131 villes dans 31 pays, dont Genève, Lausanne et Zurich, datant du printemps 2020. Il s’est avéré qu’une augmentation de la charge pollinique à environ une semaine d’intervalle entraînait une augmentation de l’incidence du Covid-19.3 Les auteur·es ont calculé que le pollen, parfois associé à l’humidité et à la température, était responsable de 44% en moyenne de la variabilité du taux d’infection à SARS-CoV-2. «Le même phénomène a été observé dans d’autres infections des voies respiratoires. L’augmentation de la charge pollinique peut donc avoir un effet assez important au niveau de la population», a constaté E. West.
Les particules fines endommagent également les voies respiratoires et une forte exposition aux particules fines entraîne une hausse du taux d’infection. Une étude espagnole a montré que la prescription d’antibiotiques pour des symptômes respiratoires aigus augmente lorsque l’exposition augmente, en particulier aux très petites particules de polluants de 2,5μg.4 «Vous pouvez imaginer la synergie qui se crée entre le réchauffement climatique, le pollen et la pollution de l’air, qui s’additionne ensuite pour donner ce taux de mortalité très pertinent, y compris dans notre population», a-t-elle déclaré.
Un autre effet du réchauffement climatique est l’apparition de nouveaux vecteurs, comme le moustique tigre, qui étend progressivement son habitat au nord des Alpes. C’est un vecteur confirmé pour des infections pertinentes comme le chikungunya et la dengue, et un vecteur potentiel pour d’autres maladies infectieuses comme la maladie à virus Zika, la fièvre jaune, la fièvre du Nil occidental, etc. Toutefois, il n’est pas nécessaire que de nouveaux vecteurs apparaissent pour que de nouvelles maladies se développent. Le virus du Nil occidental, par exemple, est transmis par nos moustiques habituels. Bien qu’il n’ait encore jamais été détecté en Suisse, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que nous y soyons également confrontés. En effet, 283 infections à virus du Nil occidental et 17 décès ont déjà été constatés en Italie en 2023.5 Des régions limitrophes de la Suisse, comme le Piémont et surtout la Lombardie, ont également été touchées.
L’augmentation de la résistance aux antibiotiques constitue un autre problème. «Il existe une interaction complexe dans laquelle le changement climatique entraîne directement une augmentation de la résistance aux antibiotiques. Lors d’événements météorologiques extrêmes, les infections d’origine hydrique sont plus nombreuses et le ruissellement de surface augmente, ce qui accroît le contact entre les organismes environnementaux et les antibiotiques. En outre, il existe des preuves que l’augmentation de la température ambiante favorise la transmission de gènes de résistance entre les bactéries»,6 a expliqué E. West.
Impact du secteur de la santé sur le climat
Au niveau mondial, le secteur de la santé est à l’origine de 4,6% des émissions totales de gaz à effet de serre.7,8 En Suisse, il est même à l’origine de 6,7% des émissions. Notre pays fait ainsi partie des principaux émetteurs de CO2. Dans un hôpital suisse moyen, l’approvisionnement énergétique (chaleur: 26%, électricité: 9%), la restauration: (17%) et l’infrastructure des bâtiments (15%) sont les domaines qui contribuent le plus à l’empreinte carbone. Ils sont suivis des médicaments avec 12%. De plus, les hôpitaux produisent beaucoup de déchets et d’eaux usées.9 Ce sont donc les mêmes domaines qui polluent le plus l’environnement, à l’hôpital comme dans la sphère privée.
Mesures pour améliorer la durabilité dans le secteur de la santé
«Les stratégies que nous pouvons utiliser à l’hôpital sont donc souvent similaires à celles que nous utilisons dans la sphère privée», explique E. West. «La mesure probablement la plus importante et aussi la plus économique est la sensibilisation à ce sujet. En Suisse, le corps médical jouit toujours d’une grande crédibilité. Nous disposons donc de conditions favorables pour encourager nos patient·es à agir contre le changement climatique. Je passe beaucoup de temps à leur parler des maladies à transmission vectorielle et de la résistance aux antibiotiques. Si vous n’avez pas le temps de mener de telles discussions avec vos patient·es, je vous recommande d’imprimer le matériel d’information destiné aux patient·es de l’ASMAC sur ce thème et de les afficher dans votre cabinet»10, déclare E.West.
«Ne vous limitez pas à vos patient·es. Parlez aussi de ce sujet avec vos collègues», a-t-elle ajouté. Cela représente déjà un grand pas en avant. Dans de nombreux hôpitaux, il existe des «équipes vertes» qui discutent de la manière dont la durabilité peut être améliorée dans leur établissement. E. West conseille de commencer par définir consciemment de petits objectifs atteignables, par exemple le passage à des menus sans viande, l’utilisation de papier recyclé, des rappels pour éteindre les appareils pendant le week-end, l’optimisation du chauffage. Pour les cabinets médicaux ambulatoires, il existe une boîte à outils de la FMH contenant une liste pratique de mesures visant à réduire la consommation de ressources et les émissions de gaz à effet de serre.11
«Un aspect important sur lequel je pense que nous devrions nous concentrer est celui des effets secondaires positifs. De nombreuses mesures durables présentent également des avantages directs pour la santé et d’autres pour les patient·es», a souligné E. West. Elle cite l’exemple d’un projet du service d’infectiologie à l’Hôpital universitaire de Zurich, qui visait à réduire le taux de pneumonies acquises à l’hôpital. L’une des mesures a été la réduction continue de l’utilisation de pailles, car elles présentent un risque d’aspiration.
L’utilisation consciente ou le renoncement aux examens d’imagerie inutiles ainsi que la réduction de la durée d’hospitalisation peuvent également contribuer fortement à la réduction des émissions. La consommation d’électricité et d’eau ainsi que la quantité de déchets par personne sont beaucoup plus élevées à l’hôpital qu’à la maison.
Comme dernier exemple, l’intervenante a cité le problème des médicaments jetés. «La difficulté à laquelle nous sommes confrontés en Suisse, c’est que nous distribuons les médicaments par boîtes entières. Par exemple, si vous voulez traiter des patient·es souffrant d’infections courantes conformément aux directives, il n’existe aucune taille d’emballage appropriée dans plus de la moitié des cas»12, a-t-elle expliqué. Il en résulte le risque de favoriser la résistance aux antibiotiques par une utilisation incorrecte ou une élimination inappropriée des comprimés excédentaires.
Conclusion
Le sujet de la «Planetary Health» est complexe et présente de multiples défis. «C’est un peu comme avec un·e patient·e souffrant d’un syndrome métabolique. Il n’existe aucune décision unique pour une mesure. Ce sont de nombreux petits changements progressifs qui, à long terme, conduisent à de nouvelles habitudes. Je vous invite à commencer par trois étapes: sensibilisez vos patient·es et vos collègues, concentrez-vous sur les avantages de la durabilité pour la santé et évitez le surtraitement chaque fois que c’est possible», a vivement conseillé E.West.
Lire l’article phare d’Atwoli et al. de 2021 paru dans 200 différentes revues médicales: Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health.
Informations utiles pour la pratique quotidienne
Source:
Congrès de printemps de la SSMIG, du 21 au 23 mai 2025, à Bâle
Littérature:
1 GBD 2021 Risk Factors Collaborators: Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet 2024; 403: 2162-203 2 Ziska LH et al.: Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis. Lancet Planet Health 2019; 3: e124-31 3 Damialis A et al.; COVID-19/POLLEN study group: Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe. Proc Natl Acad Sci USA 2021; 118: e2019034118 4 Abelenda-Alonso G et al.: Short-term exposure to ambient air pollution and antimicrobial use for acute respiratory symptoms. JAMA Netw Open 2024; 7: e2432245 5 https://tropeninstitut.de/aktuelle-krankheitsmeldungen/04.10.2023-italien-west-nil-virus 6Meinen A et al.: Antimicrobial resistance in Germany and Europe - a systematic review on the increasing threat accelerated by climate change. J Health Monit 2023; 8(Suppl 3): 93-108 7 Watts N et al.: The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. Lancet 2019; 394: 1836-78 8 Karliner J et al.: Health Care Without Harm Global Programs Annual Report – 2019. https://greenhospitals.org/news/health-care-without-harm-global-programs-annual-report-2019 9 Stucki M: «50% der Spitäler könnten ihren Umwelt-Fussabdruck halbieren.» SAEZ 2021; 102: 1490-2 10 https://vsao.ch/politik/planetary-health-informationen-fur-patientinnen/# 11 https://toolkit.fmh.ch/ 12 Füri J et al.: The potential negative impact of antibiotic pack on antibiotic stewardship in primary care in Switzerland: a modelling study. Antimicrob Resist Infect Control 2020; 9: 60
Das könnte Sie auch interessieren:
De plus en plus d’options thérapeutiques dans l’amylose cardiaque
Alors que l’évolution de l’amylose cardiaque était d’issue fatale, progressive et non influençable par un traitement il y a une dizaine d’années, il existe aujourd’hui plusieurs ...
Une voix forte pour la santé mondiale
Lors du congrès de printemps de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), Ilona Kickbusch, sociologue et politologue de renom, s’est exprimée sur la santé mondiale. Il est ...
Traitement hypolipémiant chez les personnes vivant avec le VIH
Les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) présentent un risque accru de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses. De plus, le traitement antirétroviral et ...